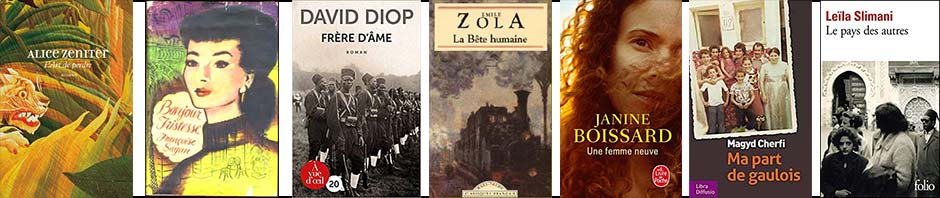.jpg) Ce livre est avant tout une critique des horreurs de la guerre et de l’occupation.
Ce livre est avant tout une critique des horreurs de la guerre et de l’occupation.
Voici quelque chose d’écrit sur la guerre qui ne pouvait être écrit que comme fiction. Non-fiction ne transmettrait pas le même impact des horreurs.
Une femme est obligée de laisser ses jumeaux avec sa mère, avec qui elle a été séparée pendant 10 ans. Les garçons ne la connaissent pas. La grand-mère est soupçonnée d’avoir empoisonné son mari, le grand-père des garçons et les villageois l’ont surnommée “La sorcière”.
La grand-mère des garçons vit juste à l’extérieur d’une petite ville, vivant d’une main à l’autre la vie paysanne, cultivant des choses sur sa terre et vendant des choses au marché de la petite ville. Elle essaie de rendre la vie des garçons aussi misérable que possible, avec son intimidation et son châtiment physique. C’est, après tout, comment on apprend la vie.
Les deux garçons apprennent rapidement à utiliser leur intelligence, à travailler et à se durcir pour s’adapter à la violence de leur monde.
Leur grand-mère est extrêmement désagréable, intimidante, sale et cruelle. Les garçons tiennent un cahier pour enregistrer leurs réunions et leurs observations. Les jumeaux se donnent des exercices pour les aider à faire face à la douleur, au froid et la faim et apprendre. Enfin, ils deviennent des autodidactes.
Une chose très distinctive à propos du roman est que les jumeaux parlent d’une seule voix. Et toujours se référer à eux-mêmes comme nous. Les deux garçons ne parlent jamais séparément ni ne discutent entre eux et semblent toujours être d’un même avis. L’auteur ne nous dit pas leurs âges ni leurs noms. On peut deviner qu’ils ont probablement entre neuf et dix ans.
L’absence de noms et d’émotions évoque pour moi la lecture de L’étranger.
Les abus sexuels et les rapports sexuels avec des mineurs sont enregistrés de la même manière que de nombreux autres événements du roman. L’histoire d’une enfance brisée et d’une innocence perdue. Les excès que l’auteur expose démontrent l’absence d’un code moral en temps de guerre.
Le premier roman d’Agota Kristof est une bonne leçon pour dire plus avec moins. L’auteur écrit de telle manière que le lecteur est toujours désireux de lire le prochain court chapitre, souvent 3-4 pages. Normalement, tout est écrit au présent.
Sa fille, Zsuzsanna Beri, explique que l’action des grands cahiers a eu lieu lorsque Agata a déménagé près de la frontière hongroise-autrichienne.
L’auteur est née en Hongrie mais a dû quitter son pays natal en 1956 à la suite du soulèvement. Elle a déménagé en Suisse et a écrit en français. Comme il était remarquable qu’à l’âge de 21 ans, elle ne connaissait pas un mot de français, elle pouvait encore gagner le prix européen de littérature française. Cela me rappelle Joseph Conrad, qui était aussi originaire d’Europe de l’Est (Pologne) et qui a écrit ses romans en anglais, une langue qu’il a commencé à apprendre quand il était dans la vingtaine.
En 2000, quand un professeur de littérature de 26 ans a acheté des exemplaires de son livre à lire à son collège à Abbeville, dans le nord de la France, il a été arrêté devant ses élèves et jeté en prison pendant trois heures.
Des enseignants, des élèves et des parents ont manifesté dans les rues d’Abbeville pour soutenir l’enseignant, qui a été libéré et autorisé à poursuivre sa carrière.