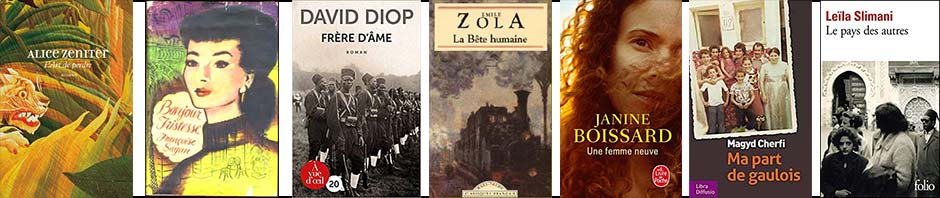9 octobre 2023
Les Mandarins est un commentaire sur les dilemmes politiques, philosophiques et moraux du Paris nouvellement libéré de 1944. Pour les intellectuels de De Beauvoir qui luttent pour comprendre où va le monde, il est temps de confusion. Sera-ce une continuation des années 1930 ou quelque chose de totalement différent ?
Beaucoup ont perdu des êtres chers. Beaucoup ont passé leur temps à risquer la capture et la mort avec la Résistance. Maintenant, tout d’un coup, ils rencontraient, dans leur vie quotidienne, beaucoup de ceux qui avaient collaboré avec les nazis, beaucoup qui ont aidé à envoyer des dizaines de milliers de leurs compatriotes dans des camps de concentration. De Beauvoir et ses associés ont du mal à comprendre le rôle que les intellectuels, les mandarins, pourraient avoir dans la création du nouveau paysage politique après la guerre.
“la paix commençait, tout recommençait : les fêtes, les loisirs, le plaisir, les voyages, peut-être le bonheur, sûrement la liberté.”
Simone de Beauvoir est née dans le boulevard Montparnasse en 1908. Ce roman à clef, Les Mandarins, a remporté le prix Goncourt en 1954.
On ne peut s’empêcher de comparer les personnages aux intellectuels bien connus qui faisaient partie de la vie de Simone de Beauvoir – Camus, Sartre et de Beauvoir elle-même. Camus, par exemple, a édité le journal de résistance appelé Combat, similaire à L’Espoir qu’Henri a du mal à éditer, à gérer et à maintenir à flot. Cependant, l’auteure a nié avec véhémence que ses personnages ressemblaient à ses célèbres associés. Même si nous croyons à ces démentis, les ressemblances restent frappantes. De toute évidence, leurs personnages ont eu une influence considérable sur son écriture.
Ces écrivains bohèmes et intellectuels de la rive gauche étaient alliés d’une manière ou d’une autre à l’existentialisme. De Beauvoir a décrit que l’existentialisme est comme “le premier engouement médiatique de l’après-guerre”. Comme beaucoup de philosophies et d’idées, le terme peut être nébuleux, difficile à déterminer. Cela semble être une réaction contre les dogmes de la religion, et dans une certaine mesure de la science, en célébrant le fait que nos vies nous donnent des possibilités. Nous ne sommes pas des automates qui suivent des vies déjà prévues. Nous avons le choix.
Le compagnon de vie de De Beauvoir, Jean Paul Sartre, est souvent considéré comme le principal partisan de l’existentialisme, un terme qu’il a popularisé, notamment dans son tome de 1943, L’être et le néant. Sartre a fait valoir qu’une proposition centrale de l’existentialisme est que l’existence précède l’essence. Les êtres humains, par leur propre conscience, créent leurs propres valeurs et déterminent un sens à leur vie. Nous sommes « condamnés à être libres ». Cette philosophie peut souvent être caractérisée par certains thèmes distinctifs : anxiété, ennui, aliénation, absurdité.
Dans Les Mandarins, De Beauvoir utilise la littérature pour dévoiler sa vision de l’existentialisme, de ses thèmes et de ses problèmes. “C’est à ça que ça sert la littérature : montrer aux autres le monde comme on le voit.”
Après un certain temps, Henri s’avère être le personnage central. Après avoir publié un roman très acclamé, nous partageons son dilemme sur la façon de garder le journal de gauche, L’Espoir, indépendant de la capitale, et des partis socialiste et communiste.
Robert Debreuilh (Jean Paul Sartre ?), l’un des écrivains les plus influents de l’époque, a du mal à comprendre pourquoi il devrait continuer à écrire, même si l’activité lui procure un grand plaisir. Il est plus enclin à la forme communiste du socialisme. Il décide de se consacrer exclusivement à la création d’un mouvement politique, qu’il a conçu comme une priorité au lendemain de la guerre.
Le personnage d’Anne Dubreuilh pourrait être cité comme un exemple précoce du féminisme de de Beauvoir. Indépendante et intellectuellement engagée, elle travaille comme psychiatre, sans se laisser enfermer dans le rôle de l’épouse soumise ou de la mère dévouée, revendiquant son droit au plaisir et à l’amour en dehors du mariage. Ce laxisme dans les relations sexuelles – Anne passe une nuit avec Scriassine – aura sans aucun doute choqué certains lecteurs de l’époque; mais peut-être pas en France ! La relation de Robert et Anne contraste avec celle d’Henri et Paule qui vivent une relation très inégalitaire. Paule n’a plus d’occupation professionnelle mais s’occupe du ménage et souhaite avant tout soutenir Henri dans sa carrière.
Après la liesse, la danse et la discothèque qui suivent la Libération, il y a le choc et le désespoir qui viennent avec la bombe A sur Hiroshima, et la prise de conscience que l’avenir est aussi précaire que le passé. “Mon Dieu ! si les Allemands avaient réussi à la fabriquer cette bombe”
Un dilemme central est de savoir s’il faut s’allier ou rejoindre le Parti communiste. Lorsque Henri reçoit des nouvelles de la Russie, suggérant que les Soviétiques ont des camps de concentration aussi mauvais que ceux des nazis, un autre dilemme est apparent. Comment peut-il savoir si les rapports sont vrais ?
Les Mandarins évoquent avec force l’atmosphère d’après-guerre parmi les écrivains et penseurs de la rive gauche de Paris. Une période qui aurait dû être joyeuse mais pleine de doutes et d’incertitudes. Bien que l’histoire se situe dans son temps et son lieu, les histoires d’amour et les dilemmes sont vraiment intemporels, et c’est là que le roman triomphe. Ce sont des livres comme celui-ci qui me rendent tellement fan de la littérature française.