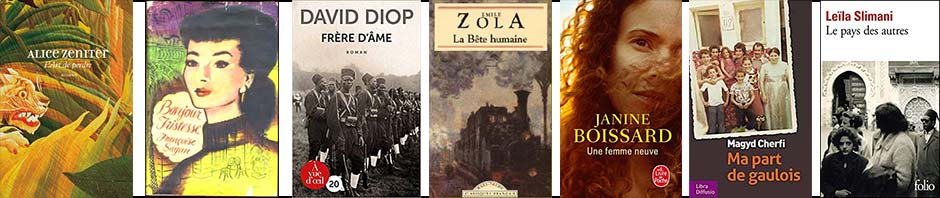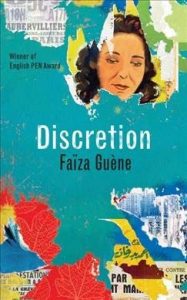lundi, 5 décembre 2022
De nombreuses grands-mères d’origine maghrébine restent invisibles entre leurs quatre murs, même en France. Oublié dans l’histoire, et dans la fiction. Et alors, le pouvoir de ce roman est de rendre visible la vie d’une telle femme. Pour nous montrer la fillette, l’adolescente, la fille, l’épouse et la mère, derrière le voile, derrière la femme, Yamina Taleb.
Le premier roman de Faïza Guène, Kiffe Kiffe Demain, a été écrit en 2004 alors qu’elle n’avait que 19 ans et a été un succès immédiat, se vendant à 400 000 bouquins. Nous l’avons lu en juin 2013. La Discrétion est son 6ème roman. L’auteur a grandi dans la banlieue nord de Paris, Bobigny et Pantin. Pendant une grande partie du roman, la famille vit dans la région d’Aubervilliers, une banlieue du nord-est de Paris.
Voila, un theme que j’observe. Les écrivains français d’origine maghrébine ont manifestement besoin de raconter l’histoire de leurs familles. Et ce sont bien des histoires qui ont besoin d’être racontées. La Discretion fait écho à L’Art de perdre d’Alice Zeniter, Désorientale de Négar Djavadi et Le pays des Autres de Leila Slimani. La Discretion se concentre sur la vie de Yamina et de sa famille. Les références à la vie dans la banlieue nord de Paris évoquent aussi des souvenirs de Grand Frere de Mahir Guven.
Notre précédent livre, Ma Part de Gaulois de Magyd Cherfi, parlait aussi de la vie de familles d’origine algérienne. Mais les styles sont si différents. Alors que Ma Part de Gaulois était rude, rauque, la vie dans la rue, le style de Faïza Guène est doux, sobre et facile à lire. Mais les deux livres, à leur manière, traitent de la meme question, qui on est ?
Yamina est née “un jour ou l’autre” dans un village d’Algerie. Quand le livre est écrit, Yamina avais 70 ans et elle est mère de Malika, Hannah, Imane et Omar, tous devenus des citoyens français qui aiment leur pays et mènent leur propre vie. Yamina manque toujours l’Algérie avec ses bons souvenirs, en particulier son figuier bien-aimé. Elle se souvient d’aimer aussi aller à l’école avec son cartable sur le dos. Elle a été forcée d’arrêter pour aider son père; et tricoter et coudre, et enseigner à ses frères et sœurs qui ont tous très bien réussi sur le plan scolaire. Elle affronte sa nouvelle vie d’épouse en France avec grâce, calme et détermination. Et sans rancune. Même si elle n’a reçu absolument aucun conseil de personne sur ce à quoi s’attendre du mariage. “Oui, devenir une femme, c’est brusque.”
La gentillesse de Yamina ne l’empêche pas d’être traitée avec discourtoisie, mépris et condescendance. Une telle humiliation fait presque exploser de colère Hannah, la fille la plus politique, tandis que Yamina fait “chut, ce n’est pas grave”. Mais cette discrétion, est-elle une puissance ou une faiblesse ?
Pourtant, c’est aussi une histoire de déracinement, de colonialisme, d’évasion de la pauvreté, d’affront au racisme et d’un terrible désir de ce qui a été laissé derrière. Pourtant, à la fin, Yamina, qui a de moins en moins de liens avec l’Algérie, surtout après la mort de ses propres parents, en vient à réaliser où se trouve exactement chez elle. C’est là où se trouve sa famille. Faïza Guène a dit ailleurs : « J’ai passé beaucoup de temps à réfléchir à mon identité. J’aurais préféré passer plus de temps à réfléchir à ma littérature ». . . “Cela,” dit-elle, “est vraiment chez moi.”
Faïza Guène a écrit que le recit de la famille de Yamina est une histoire très française. C’est une partie intégrante de l’histoire de France. Un livre comme celui-ci aide à construire sur les riches traditions littéraires de la langue française.