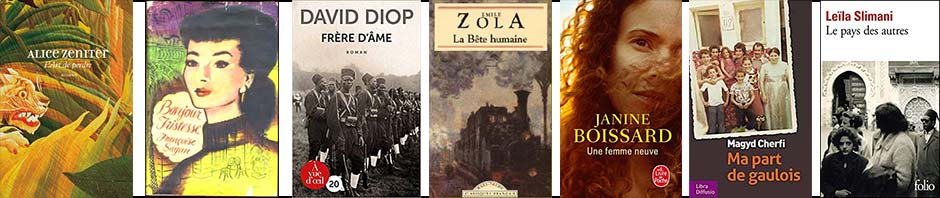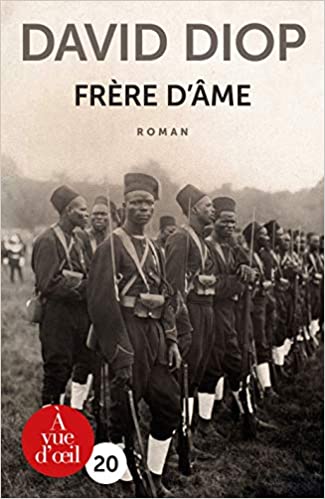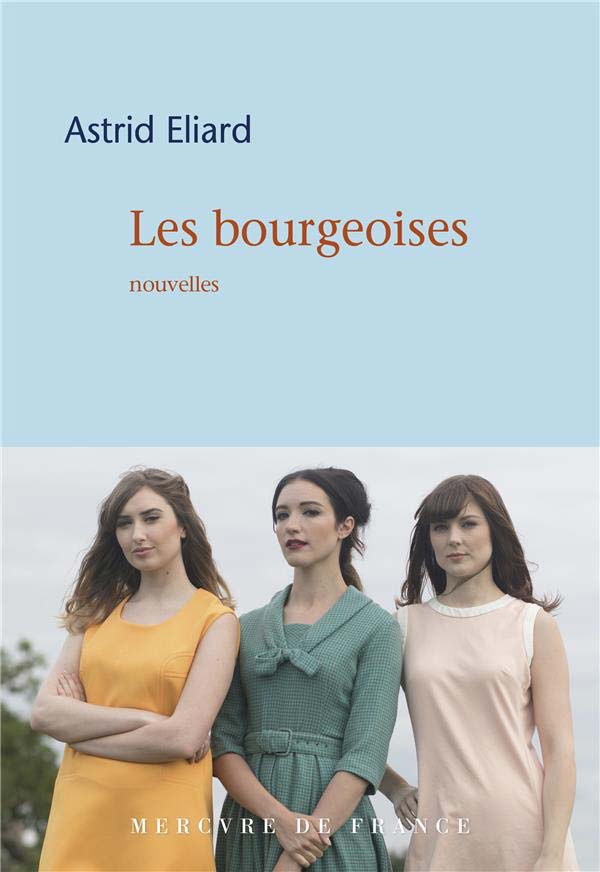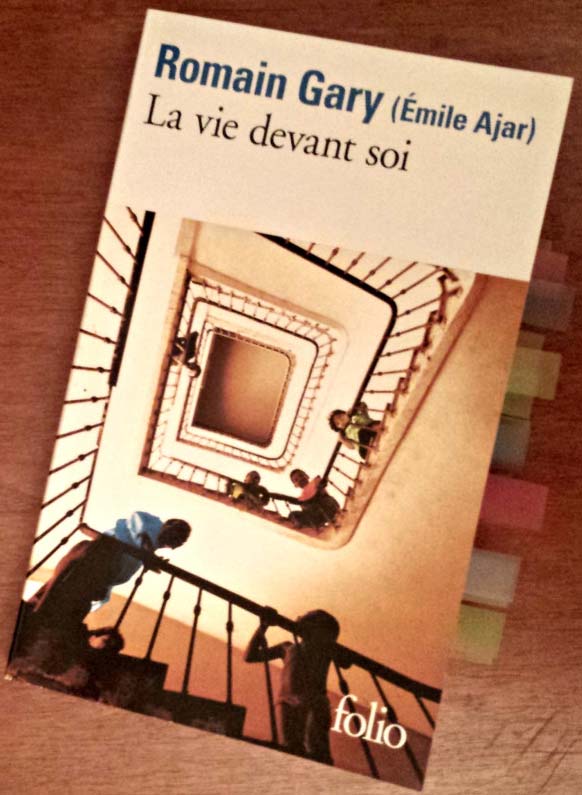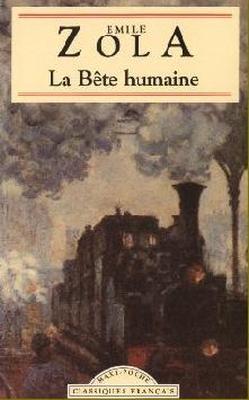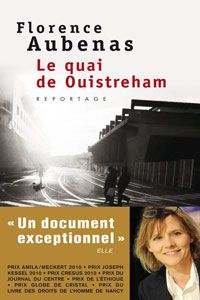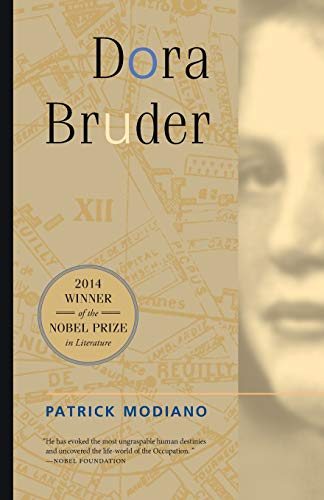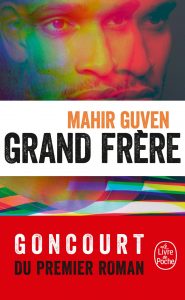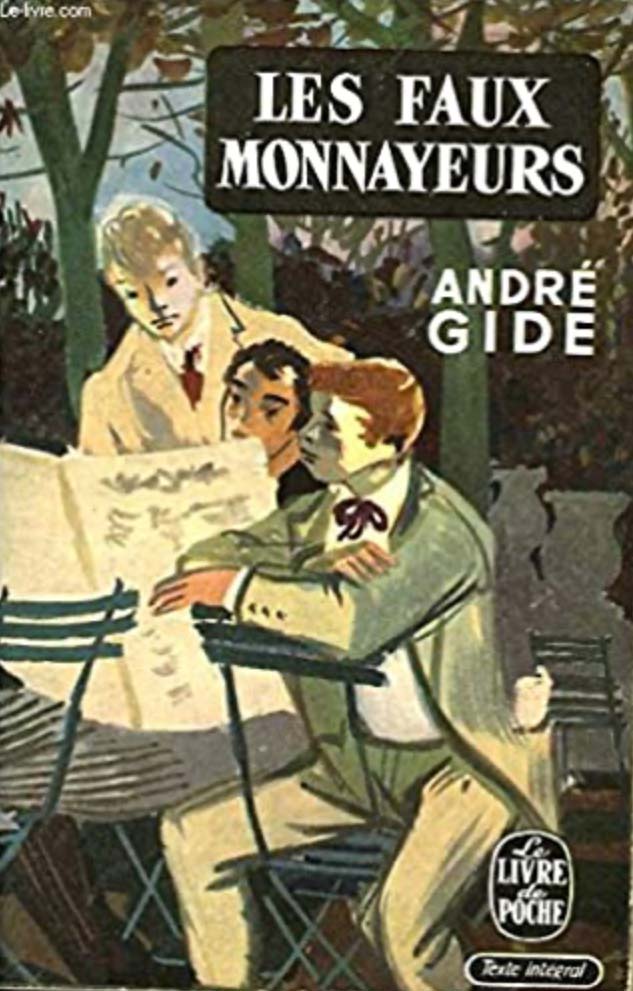1 novembre 2021
Desorientale est une histoire d’une famille élargie sur 3-4 générations où l’arrière-grand-père a un harem de 57 femmes et le père était gauchiste radical dans l’Iran pré-révolutionnaire des années 1970. La famille est contrainte de s’enfuir en 1981, voyageant à cheval à travers les montagnes du Kurdistan jusqu’en Turquie puis à Paris. La narratrice Kimiâ Sadr nous raconte son récit de sa famille et de sa vie, des contes de fées du vieil Iran à la 1001 Nuits à son départ pour les squats et la drogue, en sortant comme lesbienne, vivant à Bruxelles et à Londres avant de retourner à Paris pour visiter la section de procréation médicalement assistée. Le spectre de l’événement est omniprésent dans tout le livre.
Dans Desorientale, Négar Djavadi peint une large toile, couvrant de nombreux thèmes différents, y compris sa périlleuse évasion de Téhéran, âgée de seulement 10 ans, la famille élargie de l’auteur, les sœurs, les oncles numérotés de 1 à 6, les grands-parents, etc. Le lecteur est guidé à travers une histoire fascinante et très intéressante de l’Iran, de son histoire, de sa culture, de sa politique et de sa religion. En particulier, nous apprenons comment le coup d’État soutenu par les Britanniques de 1953, qui a supprimé le gouvernement démocratiquement élu, a eu des répercussions menant jusqu’aux temps modernes, au gouvernement autoritaires et islamique que nous avons aujourd’hui en Iran.
L’histoire commence et revient continuellement dans la salle d’attente d’une section de procréation médicalement assistée a Paris. Pour la majeure partie du livre, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est là, mais chaque fois que nous retournons dans cette salle d’attente, on nous donne un autre petit indice.
Darius, le père du narrateur, est un personnage coloré, un journaliste, un intellectuel et un adversaire vocal de gauche du Shah de Perse dans les années 1970. Malheureusement, en aidant à libérer l’Iran de la tyrannie du Shah, il ouvrait sans le savoir la voie à une tyrannie encore pire, dirigée par l’ayatollah Khomeiny. Il ne voulait pas d’enfants, puis il ne voulait que le premier, soulignant qu’Indira Gandhi était un enfant unique. Sarah ne lui a donc pas dit qu’elle était enceinte pour la deuxième fois – il l’a découvert par un appel téléphonique de l’hôpital lorsqu’elle était en travail. Le troisième enfant était Kimiâ.
Le père de Darius était Mirza Ali Sadr, dont la réputation a été ternie après qu’il ait été révélé qu’il avait un fils par une prostituée. À un moment donné, Darius entre dans le jardin de la maison familiale avec une arme à feu dans l’intention de tuer son père. Nour, la mère de Darius, et ses fils se sont installés à Téhéran avant que Darius ne parte pour l’Égypte afin d’étudier le droit. Après un an, il part pour l’Europe en travaillant dans des emplois manuels et en devenant membre du prolétariat.
Enfin, la famille se retrouve à Paris quand Kimiâ n’a que 10 ans. Elle est née en 1971 à Téhéran.
Le lecteur se demandera si l’auteur est réellement la même personne que Kimiâ Sadr. Il semble que la réponse soit « pas exactement ». Il y a clairement des parallèles, alors peut-être pouvons-nous considérer ce roman comme un autre exemple d’autofiction où le roman est une autobiographie embellie où le lecteur ne sait jamais exactement ce qui est vrai et ce qui est faction.
Négar Djavadi joue avec le lecteur. Elle nous jette de petits bouts d’information, rarement toute l’histoire avant de reculer ou d’avancer quelques années dans le temps. Une minute, nous sommes dans le harem de son arrière-grand-père Montazemolmolk et de ses 52 femmes, la prochaine fois que nous pourrions être de retour dans la salle d’attente de la clinique de fertilité ou à Téhéran, Bruxelles, Londres ou bien sûr Paris.
Négar Djavadi est également scénariste et réalisateur de films. Son compatriote cineaste, Jean-Luc Godard a écrit, « Toute histoire doit avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre-là. » Une chose que l’écriture de Desorientale n’est certainement pas est chronologique ou linéaire. Bien que ce type d’écriture puisse être considéré comme disjoint, perturbé ou désorientant, il peut également fournir une expérience plus significative au lecteur. Le lecteur doit travailler pour construire sa propre signification subjonctive du roman. Et à bien des égards, l’écriture non linéaire imite le vrai discours humain. Lorsque nous racontons une histoire à un ami, à quelle fréquence sommes-nous détournés et partons-nous en tangente ?
Lorsque Négar Djavadi décrit la vie dans les années 1970 à Téhéran, nous avons une vision de la vie similaire à celle de nombreux pays occidentaux. Ils n’auraient jamais pu imaginer qu’une telle vie disparaîtrait complètement en un clin d’œil. Ce n’est pas vraiment comparable, mais cela m’a fait penser à l’année 2000, lorsque le Brexit, Boris et la pandémie auraient semblé tout aussi incroyables. Un excellent livre que j’ai vraiment aimé lire.